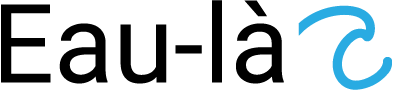Amandine avait passé les trois quarts de sa vie à bord du Saint-Casimir. Née sur l’eau et vivant sur l’eau, elle avait assumé ses tâches en bonne batelière, de la comptabilité jusqu’aux soins ménagers, sans parler du pilotage où elle excellait. Faire virer ou laisser revirer le macaron lui était familier et elle aurait pu à elle seule conduire un fret de cent tonnes de céréales de Lyon à Maastricht, ce qui n’est pas rien.
Mais Amandine rêvait de voir la mer.
« Et pourquoi donc ? demandait son Joseph.
– Parce que je ne l’ai jamais vue », s’en attristait-elle.
Dans la chambre conjugale, elle avait punaisé sur les lambris des cartes postales ou des découpes de magazines où l’on pouvait voir le Mont-Saint-Michel ou Copacabana. Les plages de sable fin, les cocotiers nonchalants, la baie des Anges, les îles Baléares ou dalmates peuplaient ses rêves comme saint Antoine peuplait les siens d’odalisques ou de sultanes tendrement avachies sur des sofas de velours.
Un jour, n’y tenant plus, elle dit à son Joseph :
« Voilà, c’est décidé, je veux voir la mer. »
L’autre poussa un soupir plus long qu’un bief d’écluse, puis consentit :
« Très bien. Nous irons voir la mer, mais à vélo.
– A vélo ? dit Amandine. Et pourquoi pas en bateau ?
– Le Saint-Casimir n’est pas fait pour cela. A l’approche des estuaires, il renâcle et geint sous l’effet du flux et du reflux. La mer qui monte ou qui descend ne lui convient pas. Les anguilles et les morues ne font pas bon ménage. Mais nous irons à la mer. A vélo ».
Ils y allèrent. Une fois atteinte une haute falaise, Amandine s’écria : « Que d’eau, que d’eau ! » comme ce roi de France qui, lui aussi, découvrait la mer pour la première fois. La contemplation dura deux jours.