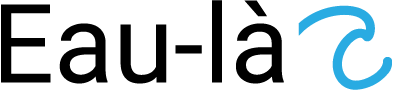L’eau musicienne
Contrairement à ce que croient certains terriens, le monde des fleuves et des rivières, même quand ils sont sages et lents, résonne de musiques concrètes. Tantôt douce, tantôt stridentes, que l’on peut encore savourer. C’est qu’à bord, les instruments ne manquent pas.
« Oui, je sais, racontait un marinier, expliquant comment tout cela le faisait vivre. Les gens d’à terre qui ne nous voient que passer, nous prennent pour des transporteurs pressés de livrer leurs cargaisons. Je me souviens pourtant de chacun des bruits qui m’accompagnaient, de toutes les musiques des gens de l’eau. Il y avait bien sûr le « doug-doug-doug » du moteur à la poupe. Et puis le bruit de l’eau qui faisait de longs « chuit-chuit » à la proue. Et encore celui du vent qui faisait vibrer les haubans et claquer les drapeaux. Sans parler des chemins de hallage au bord desquels peupliers, aulnes ou roseaux chantaient tout à leur façon. Le bruit même du bateau résonnait différemment selon que la cale était vide ou pleine à ras bord. Pleine, elle divulguait un « bas bruit » et l’on entendait à merveille le chuintement de l’eau le long des bordages. A tout ces sons inattendus s’ajoutaient naturellement les vrais instruments de musique qui égayaient les voyages. En ce temps-là, point de radio ni de télévision. Les mariniers bricolaient eux-mêmes ce qu’on appelaient des « bûches de batelier » ou autre « épinettes » — six planchettes assemblées et cinq cordes métalliques réalisées à partir de câbles de freins de vélo — qui suffisaient à lancer le rigaudon. Lorsque l’on prenait le départ, la musique commençait, il n’y avait plus qu’à écouter. »